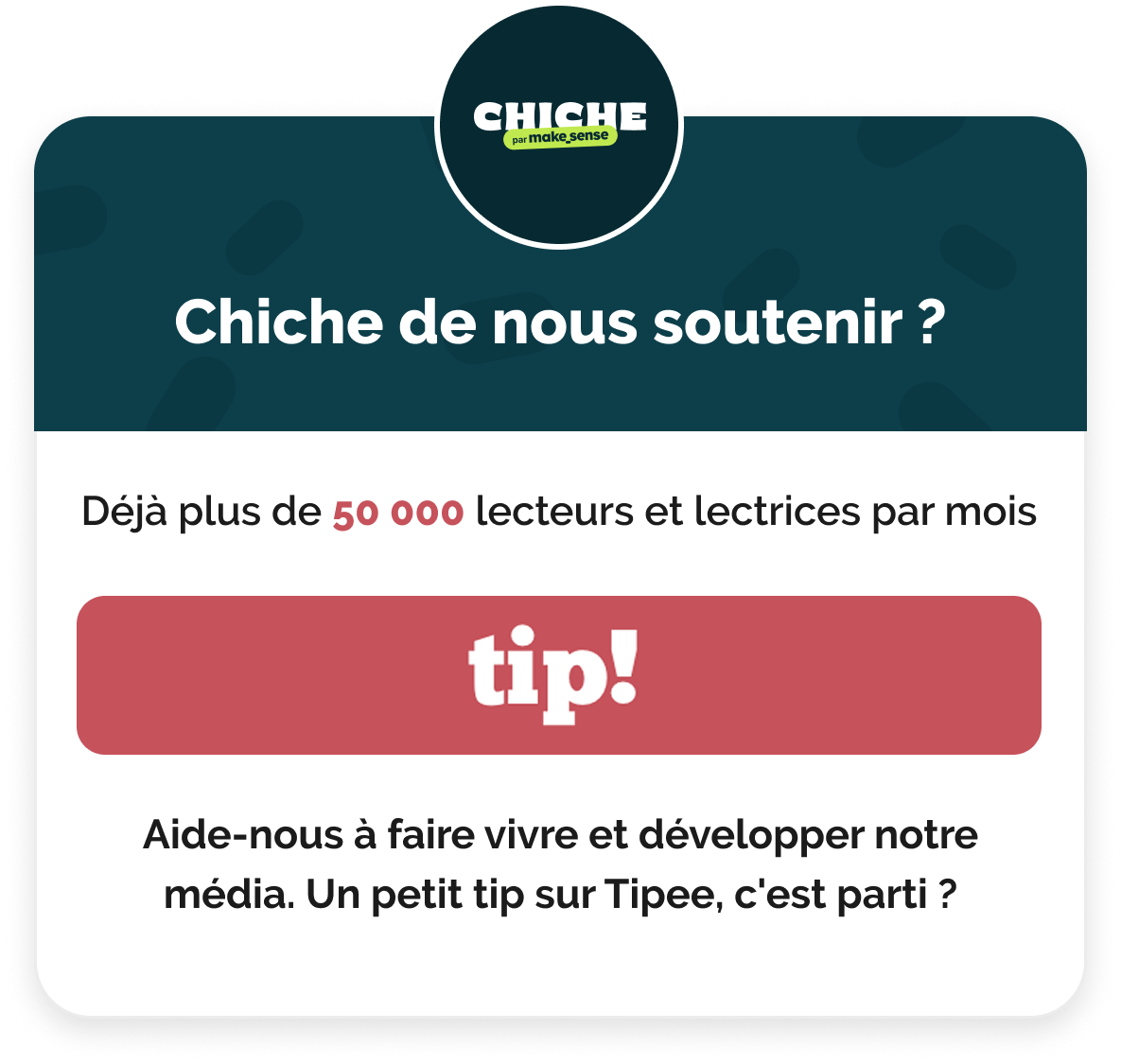Après les 9 321 petits traités publiés au sujet de la lenteur, les 44 Ted X intitulés “Ralentir, c’est super” mais aussi les prochains “Festival de la lenteur” organisés par les néo-ruraux en campagne, on ne voit pas pourquoi nous, à Chiche, on n’ajouterait pas aussi notre petite pierre à l’édifice. Il faut croire que la prolifération de recherches et réflexions sur le ralentissement sont à la hauteur de l’importance du sujet. Allons-y gaiement, allons-y doucement.

C’est pas ma faute à moi
Avez-vous déjà observé un troupeau de ruminants paisiblement rangé dans un coin de pré, à l’ombre de quelques rameaux d’aubépine ? Il arrive parfois que l’un d’entre eux décide soudainement de se relever, suivi par son compère qui se relevant se met à marcher, suivi d’un troisième dont la marche devient petite foulée… et c’est en quelques instants l’ensemble du cheptel qui détale le long d’une diagonale collectivement improvisée. Course folle, course molle. Et après quoi ? On ne saura jamais.
Elles sont amusantes ces bêtes. Bête à poils. Bêtes un poil idiotes aussi, disons-le en toute camaraderie.
Ce n’est pas l’être humain et son encéphale glorieusement démesuré qui s’abaissera à courir pour la simple et mauvaise raison que tout le monde autour de lui, court aussi. Quoique.
Accélération sur un trottoir bondé. Enjambées frénétiques sur le quai de la gare Saint Lazare. Sprint pour atteindre le rayon fromage avant ce type, sûrement à la retraite d’ailleurs… Il vous arrive peut-être parfois de vous arrêter et de vous demander pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous suivez celui que vous êtes en train de suivre. Je ne pense pas donc je suis (et je cours). Sensation d’urgence désagréable aux arrières-goût grégaire, pour revenir à nos moutons.
Commençons donc par mettre toute l’humanité dans ce même panier de la hâte. Retirons-y à la rigueur, les poètes, les amoureux et les nouveaux nés. C’est à ce groupe-là que s’adresse cet article.

Pourquoi chercher pourquoi ?
“C’est un peu la course en ce moment”, “Tout va tellement vite”. Un récent sondage a prouvé que 102% de la population a prononcé l’une de ces deux phrases au moins une fois lors de la dernière année écoulée.
Il y a derrière ces apparentes banalités glissées entre deux commentaires météorologiques une question plus que périlleuse : si la course nous épuise, pourquoi courons-nous ?
Pour une partie d’entre nous, la réponse est aussi claire que violente. Il faut vivre, il faut survivre, il faut se plier aux règles d’une partition écrite par d’autres, sur un rythme infernal. Cours ou crève. Eux et elles sont propulsés sur une autoroute dont le seul but est d’accélérer, sans même savoir où tout cela mène.
Et il y a celles et ceux qui ont le privilège de ne pas, ou moins, subir. Ceux et celles qui ont le temps de réfléchir, voire de contribuer à modifier les règles du jeu existantes. Mais la plupart du temps, eux et elles, nous peut-être, sommes cramponnés au volant. Appuyant sur la pédale d’accélération (le frein est juste à côté pourtant, c’est con). C’est bien ce cockpit-là, cœur de la machine qui n’a d’autre choix que de ralentir.
Comprendre le pourquoi de cette drogue qu’est l’hyper-vitesse nécessiterait de réunir une armée de philosophes, historiens et historiennes, anthropologues, psychologues, sociologues et tous les autres “ogues” de votre choix. Une fois réunis, on les laisserait travailler une vingtaine d’années pour nous pondre un truc bien solide. Ce serait passionnant, utile (déjà fait ?) mais aussi un peu long, parce qu’au départ on voulait juste écrire un petit article, nous. Alors retournons la question et attaquons le sujet par l’autre bout. Par la lenteur, donc. Un coup de foudre pour la lenteur entraînerait de facto l’abandon de la course à la vitesse. Alors, tombons en amour dès à présent.

Un peu beaucoup trop calme
Et bien NON. Non, nous ne sommes pas d’accord avec le “tout va trop vite”. Une partie du monde va vite, pas “tout”. La lenteur, reste présente un peu partout, vrac d’exemples pour vous :
- Dans nos nuits, personne ne sait (encore) comment “dormir très vite”
- Dans la respiration qui nous traverse (et qui n’accélère que rarement, pour les grandes occasions : coup de foudre, arrivée du serveur au restaurant qui chantonne “la croziflette au bleu d’auvergne c’était pour vous ?” et récitation du poème “Les passantes” devant le reste de la classe),
- Dans l’écriture d’une carte postale, surtout si elle est ornée d’un paysage de bord de mer,
- Dans tout ce qui est vivant en dehors des Sapiens. Excepté si vous tombez nez-à-nez avec un phacochère de mauvaise humeur ou un taon syndicaliste, mais là c’est que vous portez la poisse,
- Dans l’acte de sourire, essayez vous-même de sourire très vite, c’est extrêmement bizarre voire effrayant.
Bref, la lenteur n’est pas une grande gueule, ce qui ne l’empêche pas d’en avoir, de la gueule. La lenteur est partout, et c’est souvent beau de la voir passer, ou à défaut de la sentir à l’affût.
La question est : peut-on extirper de cette manne logée dans les interstices de nos vies la douceur d’un fracas révolutionnaire ? Cette lenteur anodine peut-elle devenir un enjeu politique, un hymen nouveau, une règle radicale ?
La lenteur, piètre bataille mais grande guerre
Vous avez décidé de vous rendre ce soir au verre de l’amitié organisé par la section locale de votre parti politique préféré. La question qui est posée par le responsable à l’ensemble du groupe est simple : “On fait quoi ? Quelles sont nos prochaines actions ?”
Vous décidez de répondre, sans trop réfléchir : “Allons marcher main dans la main au bord de cette rivière sillonnant notre village pour prendre le temps de ralentir et écouter ce que cette décélération nous inspire”. Instantanément, vous provoquez une gêne d’incompréhension doublée d’un plombage d’ambiance carabiné.
Et malgré cela, vous persistez et signez. Vous vous expliquez. Stratégiquement et contre toute apparence, la lenteur est gagnante. Vous en êtes convaincu comme un platiste est convaincu qu’il tombera un jour dans le vide s’il suit un ligne droite avec persévérance. Et on l’embrasse.
Certes, dans un premier temps, être lent, c’est perdre. Exemple éclatant avec le chaos de la non-vie digitale : en ligne, c’est bel et bien celui qui dégaine le premier qui gagne. Vous réfléchissez avant d’agir, vous vous taisez avant de parler et les autres vous grillent la priorité. Et vous perdez.
Et puis arrive le plus faiblard de tous les guerriers, le perdant magnifique. Nom : Ellul. Prénom : Jacques. Juriste, théologien, penseur, philosophe, cet être non identifié (que l’on aimerait propulser comme future star de la décennie) nous explique que la civilisation capitaliste actuelle est une course aveuglée et aveuglante à l’efficacité. Autrement dit, le seul et unique critère qui guide nos choix, nos politiques, les orientations de nos sociétés, c’est l’efficacité. Cette règle d’or n’est remise en cause que par quelques inconscients comme lui, Jacques Ellul.
Il poursuit ainsi (attention : énorme raccourci de sa pensée foisonnante et tranchante sur le sujet). Pour être cohérent, il faut accepter de perdre avant de gagner. Adopter une lutte cohérente, c’est-à-dire qui “montre l’exemple”, c’est-à-dire encore accepter de ne pas utiliser les moyens que l’on dénonce pour dénoncer. Et ainsi combattre l’efficacité sans efficacité. Lutter en acceptant d’être inefficace, dans un premier temps au moins. Et tout est dans ce “dans un premier temps”. Perdre des batailles, oui, mais dans l’espérance que ces défaites, mises bout à bout, finissent par être couronnées par une victoire finale, inattendue mais bien réelle. Et cette espérance, comment la trouver ? Comment la conserver au fond de nos êtres ? Tout est là.
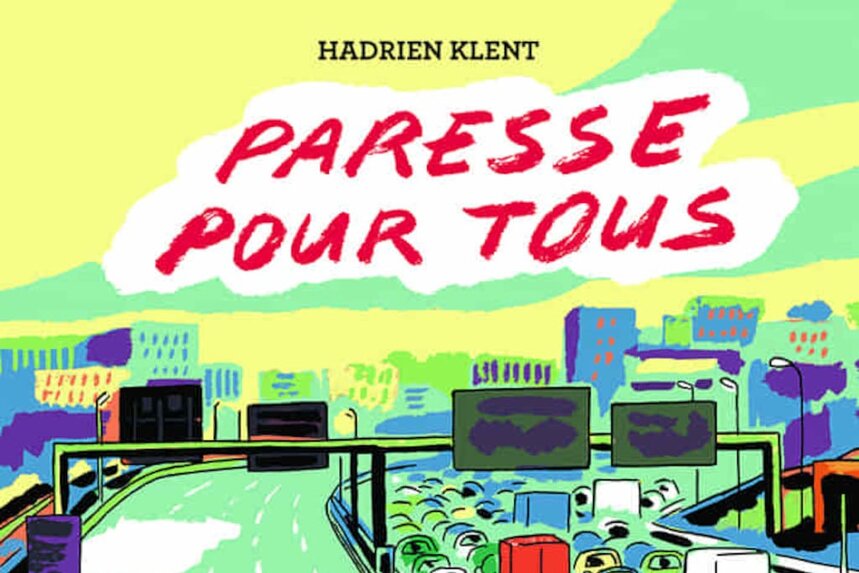
Les mains dans le cambouis de la lenteur
C’est bien beau ces mots mais alors quoi ? À quoi ressemblerait l’avènement d’une lenteur généralisée ?
Dans son livre “Paresse pour tous”, Hadrien Klent raconte l’accession au pouvoir d’un certain Emilien dont le programme comporte une idée phare : travailler 3 heures par jour, pas plus. Inspiré de Paul Lafargue et de son “Droit à la paresse”, Hadrien Klent illustre ici que c’est d’abord la question du “travail” et plus largement économique qui est à prendre à bras le corps. Les municipales arrivent, et derrière la présidentielle. En 2017, Benoît Hamon et son revenu universel avaient mis en lumière le désir très majoritaire de notre populace à questionner nos rythmes et notre rapport au labeur. 2027, dix ans plus tard, sera-t-elle une année où l’un, l’une ou l’autre des candidat·es aura l’audace de proposer un ralentissement général de nos sociétés ? Soupir peu convaincu.
Revenons à un niveau moins vertigineux, celui de nos vies.
Comment ralentir, comment dans nos chairs éprouver ce que “ralentir” veut dire ? On vous partage quelques idées et on en attend de nombreuses que vous aussi, vous expérimentez :
- L’agenda papier : étonnement, tourner les pages des temps à venir est une manière simple mais efficace de moins craindre ce qui est venir et peut-être aussi de ralentir quand une case est déjà griffonnée de plusieurs événements.
- Le vert : nous enfonçons des portes ouvertes pour que la lumière passe à l’intérieur. Tout ce qui est vert, gorgé de chlorophylle et de chloroplaste est a priori très, très lent. Tentons de les approcher et de papoter, voir ce qui adviendra.
- Les autres : rencontrer, pour de vrai, quelqu’un qui nous est opposé sur au moins un critère (l’âge, la langue, la culture, le métier). Ça prend du temps, c’est lent et comme on dit, plus on est de fous, plus on r(alent)it.
- Les chemises : c’est assez long à boutonner une chemise, ça oblige à se contempler dans le miroir en se disant qu’on va y arriver, que le ralentissement est en marche.
- La saison froide : l’automne est officiellement commencé, préparation à ces quelques mois où le vivant s’est mis d’accord pour dormir plus et bouger moins. Alors suivons l’exemple, après tout, le vivant, c’est nous aussi.
- La marche : faire un trajet en 5 minutes en voiture, donc 20 en vélo, donc 1 heure à pied. C’est long, c’est lent. Mais mystérieusement, ça change quelque chose, pendant et après.
- Le verbe “mijoter” : le plat qui mijote dans le four ou sur le feu est une formidable métaphore de notre futur. Plus on attend, plus c’est lent, plus le goût ressort, plus la vie est là. Alors mijotons nos existences, non ?