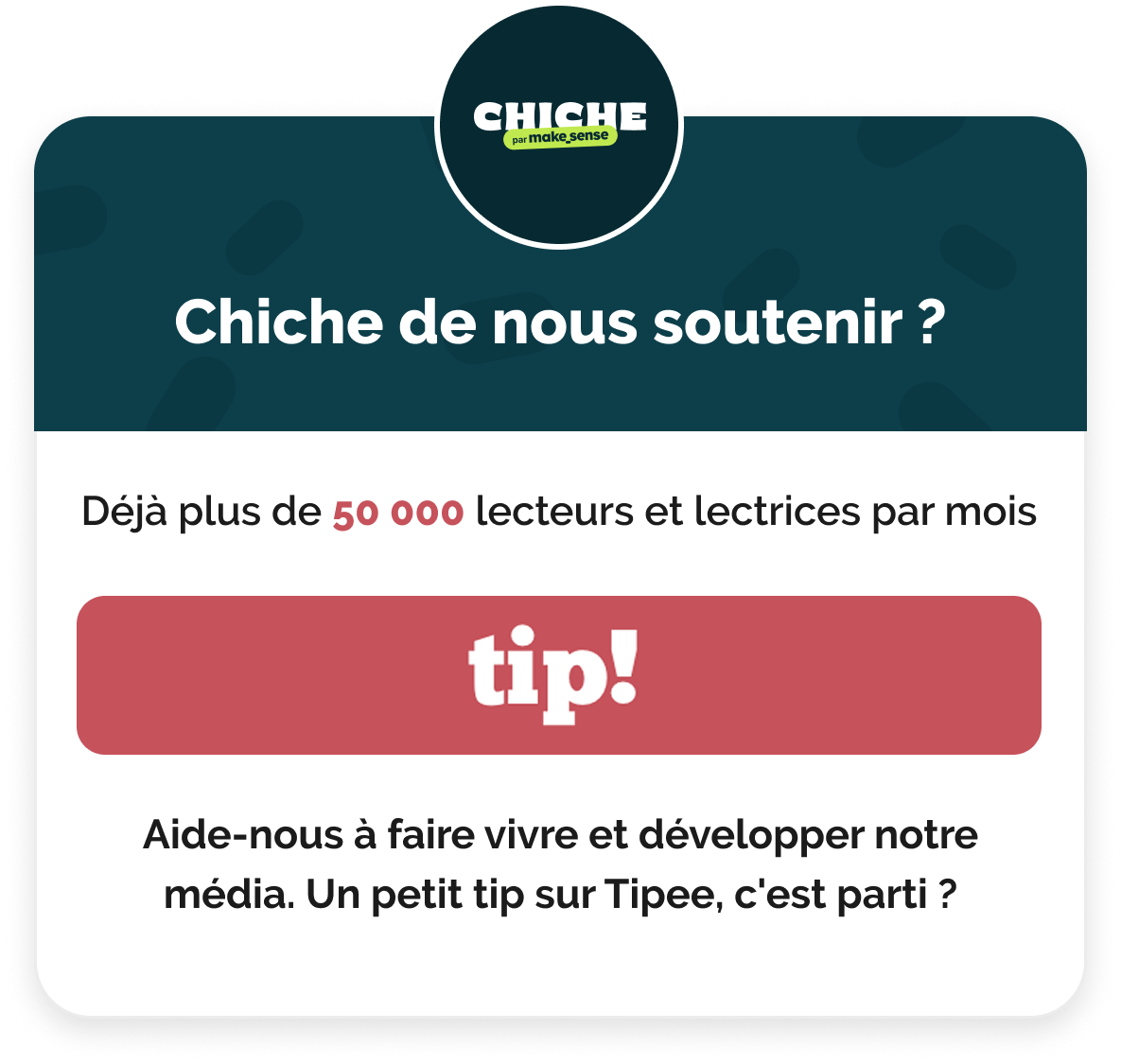Face au culte de la réussite individuelle et aux illusions de la méritocratie, le “refus de parvenir” propose une autre voie : rester fidèle à sa classe, refuser la compromission et chercher la dignité plutôt que la gloire. Chiche
Etes-vous un·e vrai·e écolo ? Un·e militant·e intransigeant·e ? Un·e employé·e modèle ? Avez-vous réussi dans la vie ? Et si oui, qu’est-ce qui vous permet de le croire ? Vous avez eu une promotion ? Votre boss vous paye mieux que les autres ? Vous exercez un métier mieux considéré que celui de vos parents
Ça fait beaucoup de questions, je vous le concède. Aujourd’hui, on va se pencher sur la houleuse question de la non-réussite comme fin en soi : le refus de parvenir. Étymologiquement “parvenir” signifie “trouver une issue”. Le sens du verbe n’a rien de péjoratif contrairement à sa forme nominale “parvenu” désignant généralement celui ou celle qui se meut dans une classe supérieure dont il ne maîtrise pas les codes et les manières. Le parvenu est devenu un personnage littéraire en tant que tel, on le trouve dans le personnage balzacien Rastignac ou plus encore dans l’éponyme Martin Eden de Jack London c’est aussi un objet de risée au théâtre dans les textes de Marivaux.
Mais d'où vient ce concept ? Il naît au début du XXe siècle, dans les milieux enseignants anarchistes en la personne d’Albert Thierry. Ce syndicaliste libertaire n’était pas seulement signe astro vierge, mort beaucoup trop jeune sur le front à 33 ans (la guerre, pas le haut du visage), il est aussi le théoricien du “refus de parvenir”. Après avoir refusé une carrière en or dans l’enseignement, il offre ses services à une école primaire de Melun auprès d’élèves fils d’ouvriers et de paysans pour la plupart.

Classe, je ne trahirai point
Ah oui faut préciser aussi, Albert Thierry est fils de maçon. C’est fondamental dans sa pensée car son choix de fuir l’enseignement des élites résulte avant tout d’un désir de ne pas trahir sa classe sociale. Il explique ainsi “Refuser de parvenir, ce n’est ni refuser d’agir ni refuser de vivre : c’est refuser de vivre et d’agir pour soi aux fins de soi”. L’ascenseur social étant fait ainsi : parvenir à gravir les échelons de la société, plus on s’extirpe de sa classe, plus on serait un modèle de réussite. Les fameux “transfuges de classe” qu’on adore citer pour perpétuer la croyance selon laquelle la mobilité sociale serait accessible à tous, incarnent ainsi à leur corps défendant le mythe de la méritocratie.
Le refus de parvenir s’érige au contraire comme un choix de ne pas se laisser corrompre par les joyaux du capitalisme (= la grosse moula). Pas étonnant que ce concept revienne au devant de la scène en mai 68. Les étudiants ne veulent plus finir comme des cadres en entreprise qui exploitent la classe ouvrière.
Vous reprendrez bien une tasse d’intégrité ?
Cette effervescence donne lieu à une nouvelle action politique : les établis ! Influencés par la Révolution culturelle maoïste en Chine, ces étudiants aux diplômes bien garnis décident d’aller s’établir à l’usine (à ce sujet lisez L’établi de Robert Linhart, adapté au cinéma en 2023 et très éclairant sur le sujet). Un mouvement qui n’est pas sans rappeler celui des “déserteurs” de AgroParisTech en 2022 qui appellent à ne plus accepter de carrière dans des entreprises polluantes incitant plutôt à miser sur des emplois “utiles”. Une désertion collective et politique bien résumée dans l’essai de Jeanne Mermet désertons. Le récit de cette ancienne élève de Polytechnique qui explique pourquoi elle a refusé d’embrasser une carrière d’ingénieure pour rester en accord avec son militantisme.
Tous milliardaires
Emmanuel Macron déclarait en 2015 ““Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires”. Au delà de l’absurdité mathématique d’une telle déclaration (le principe même du concept de milliardaires c’est qu’il y en a peu et qu’ils prennent les richesses de tous les autres), elle témoigne d’une volonté intrinsèque de viser la richesse comme unique finalité de réussite. Car le refus de parvenir est à comprendre au sens individuel, on troque sa réussite personnelle pour le bien commun dans un objectif de réduction des inégalités avec une vision non-hiérarchique du travail.
En ceci, on voit bien que la pensée d’Albert Thierry résonne certes avec notre présent mais nécessite quelques ajustements puisque notre passion de la consommation matérielle n’est pas exactement la même aujourd’hui qu’au début du XXe.
La dignité du présent
OK j’avoue. Corinne Morel Darleux n’est pas vraiment un symbole de non-réussite puisqu'elle a entre autre sorti un best seller en 2019 Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Dans cet essai philosophique, elle reprend à son compte la théorie d’Albert Thierry qu’elle pose notamment en regard du navigateur Bernard Moitessier.
En 1969, ce p’tit bonhomme est sur le point de remporter la première course autour du monde sans escale et sans aide extérieure (il en fait le récit dans La longue route) et puis PATATRAS. Il décide juste avant d’atteindre la ligne d’arrivée de… renoncer. Il catapulte alors un message vers un paquebot dans lequel il explique qu’il ne va pas finir la course, qu’il renonce à la victoire et qu’il change de cap (et globalement qu’il nous emmerde au passage).
“Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme.” De quoi nous inspirer sur le sujet. Et pour cause, Corinne Morel Darleux voit dans le refus de parvenir une “dignité du présent” qui consiste à accepter notre impuissance (cf. nos gestes écoresponsables qui pèsent pas lourd face aux entreprises ultra polluantes et aux milliardaires qui achètent l’intégralité des médias pour diffuser leurs idées d’extrême-droite et leur goût du climato-scepticisme mais fin de la parenthèse j’me suis emportée dans ma digression) tout en restant en accord avec nos valeurs. En gros, on peut se dire qu’on renonce à être une star de cinéma (perso j’ai fait mon deuil de ce projet en 2008) mais aussi qu’on renonce à être un écolo parfait (parce que la vérité elle était trop tentante cette tranche de saucisson Justin Bridou fabriquée avec du vomi de satan).
Aujourd’hui, le refus de parvenir ne se limite pas au fait de grimper socialement mais aussi de refuser l’accumulation matérielle. Idem pour la culture, le refus de parvenir c’est adopter une approche désintéressée de la culture, on peut faire des études et apprendre sans utiliser ce levier pour sortir de sa classe mais au contraire pour l’alimenter intellectuellement. Plus qu’un courant de pensée, le refus de parvenir, c’est aujourd’hui une philosophie de vie qui n’a rien d’austère. Paul.
MDR
Je finis sur un refus de parvenir à être drôle, et vous ?