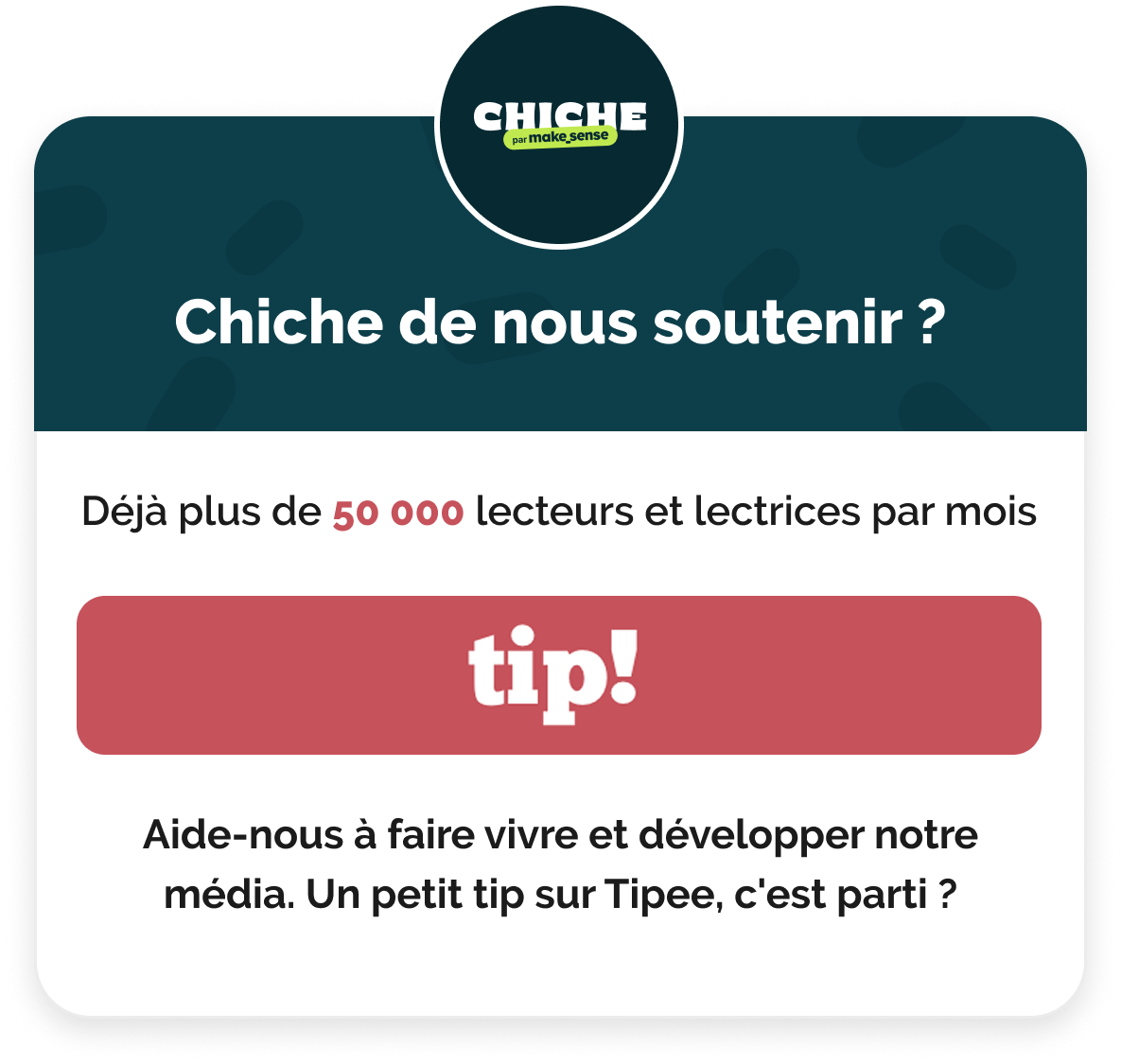Les conséquences du changement climatique obligent les sports en nature à reconsidérer leur pratique. En Seine-et-Marne, le club de Torcy Canoë-Kayak tente de s’adapter face aux crues toujours plus fréquentes.
« Attention, quand on embarque on met la pointe en avant parce qu’il y a beaucoup de courant », prévient Charlie pendant que les jeunes du club de canoë-kayak mettent les bateaux à l’eau. Cet après-midi, Patrick Charlaigre, surnommé Charlie, encadre un groupe de débutants du Torcy Canoë-Kayak, âgés de 8 à 15 ans. Après avoir enfilé leurs tenues étanches, les adolescents embarquent les uns après les autres sur la Marne agitée.
En ce mois de février, les conditions ne sont pas optimales pour naviguer. "Aujourd’hui, c’est 300 mètres cubes par seconde qui passent devant nous. En temps normal, ce serait moins de 100 mètres cubes", commente le collègue de Charlie, Julien Fougeron, le regard porté sur la rivière en crue qui va donc trois fois plus vite que d’ordinaire. En temps normal, la Marne revêt une couleur verte quand là, « elle est marron, chargée en boue à cause du débit ». Et ce, huit mois dans l’année contre trois habituellement selon les deux salariés qui naviguent sur la Marne depuis, respectivement, 30 et 40 ans. "Ça fait trois saisons qu'on observe des choses qui ne sont pas très normales », reconnaissent ces témoins directs des conséquences du changement climatique.

Sur le podium des sports les plus touchés par le changement climatique
À l’autre bout de la France, en Savoie, où vit l’ex-athlète de haut niveau en kayak slalom Jimy Berçon, le Rhône aussi voudrait sortir de son lit. « On observe un débit très élevé ces derniers mois, à tel point que le stade d’eau vive qu’on utilise est noyé », indique le champion de France 2011 de la discipline plébiscitée aux Jeux de Paris 2024. Après sa carrière dans le haut niveau, Jimy Berçon s’est spécialisé sur les questions de la transition écologique dans le sport. Selon lui, le kayak en rivière est l’un des sports les plus touchés par le changement climatique parce qu’il est confronté à une double contrainte : crue et sécheresse. « Soit tu ne peux plus pratiquer parce qu’il n’y a plus d’eau, soit parce qu’il y en a trop », résume Jimy Berçon qui rappelle qu’à l’été 2023, plusieurs compétitions ont été annulées car les rivières étaient asséchées.
Ramer et s’adapter
Face à ces nouvelles contraintes, le sport n’a pas d’autres choix que de s’adapter. Pour les Jeux de Paris 2024, les épreuves de Canoë slalom et de Canoë sprint se sont déroulées dans un bassin artificiel à la base nautique de Vaires-sur-Marne. Ces stades d’eau vive qui fonctionnent grâce à une pompe ont été utilisés pour la première fois aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. « On ne trouvait pas les bonnes conditions là-bas, alors on s’est affranchi du problème en créant une structure artificielle », relate Jimy Berçon. Or, ce type d’équipement est devenu récurrent. L’ancien athlète de haut niveau y voit l’illustration de la « maladaptation » des sports : « On s’adapte en consommant encore plus d’énergie et donc en étant responsable d’émissions de gaz à effet de serre ».
Comment bien s’adapter ? Jimy Berçon évoque plusieurs pistes : l’aménagement du calendrier des compétitions ou encore l’évolution des règles du jeu. Il imagine également une plus grande souplesse du cahier des charges des compétitions : « aujourd’hui, quand toutes les conditions ne sont pas réunies, on annule la rencontre. On pourrait très bien se dire que sur certaines échéances, si seuls 150 m sont navigables plutôt que 300 m, on pourrait passer sur un format plus court ».
À l’échelle de leur club, Charlie et Julien modifient les exercices en fonction des conditions et favorisent certaines disciplines. « Nous ce sont les disciplines en eau calme qui sont impactées, on va privilégier les bateaux de vitesse de descente qui sont un peu plus stables ».

Une pagaie dans la mare
Ce qui inquiète le club de Torcy, c’est l’ouverture de la discipline au plus grand nombre. « On n’a pas pu faire de la location cet été parce que c’était trop dangereux de mettre des débutants sur l’eau », regrette Julien. Et Charlie d’ajouter : « économiquement, on perd des séances et pour le club, de potentiels futurs licenciés. C’est double peine ».
Le risque d’attractivité à long terme est réel. « Si pendant six mois il n’est pas possible de faire du kayak en rivière, les pratiquants vont arrêter. Si on ne veut pas les perdre, on a intérêt à être le plus résilient possible », conclut Jimy Berçon.