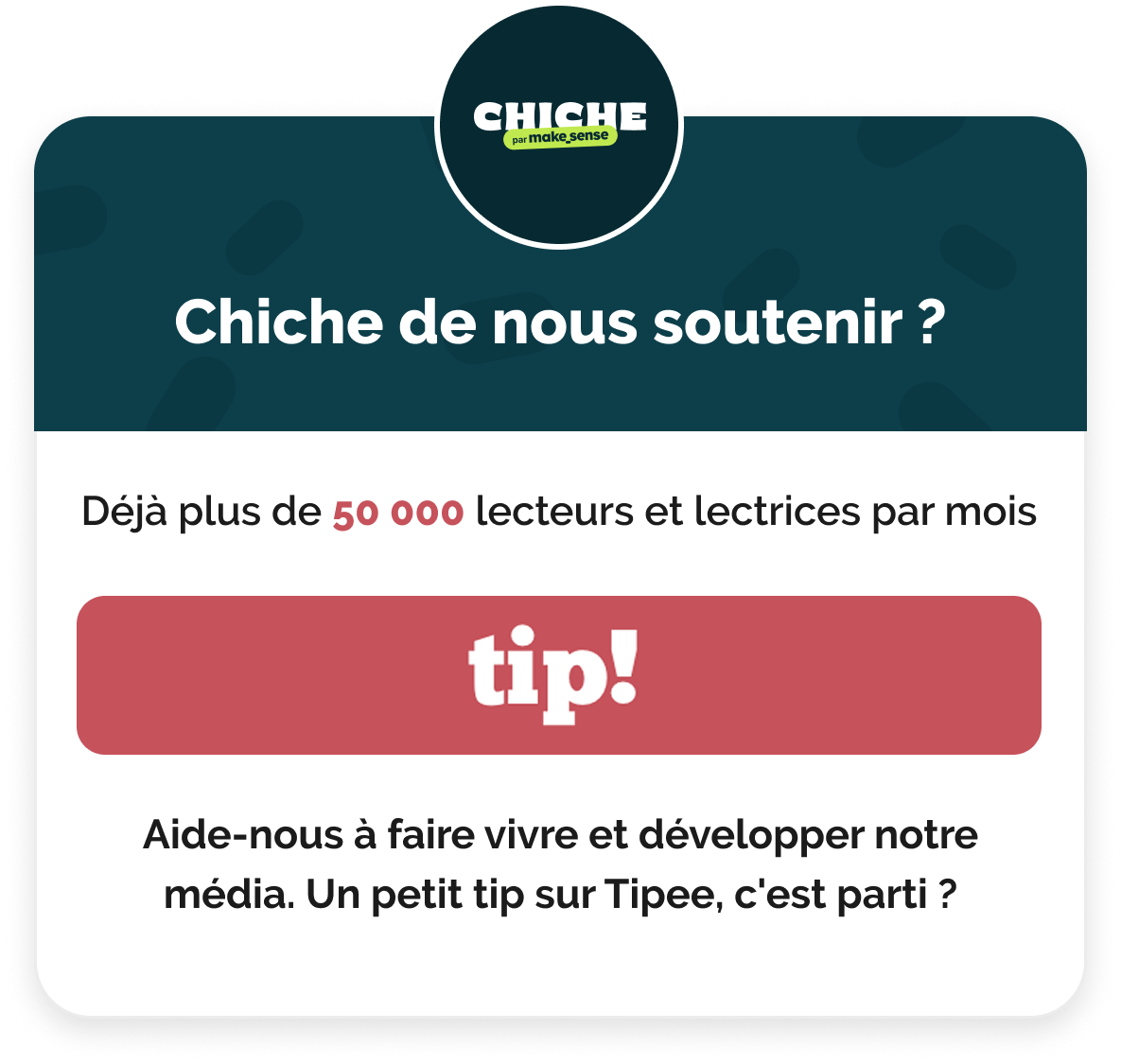Juin 2025, mois de la 3e conférence mondiale sur l’océan, d’un enjeu aussi crucial que planétaire, d’une programmation éditoriale signée Mouv’outremer pour explorer l’adaptation du littoral aux dérèglements climatiques. Audrey Pastel, Matthieu Juncker et François Tron ont apporté leurs éclairages précieux sur les enjeux spécifiques des Outre-mer et sur les solutions locales, fondées sur la nature et l’engagement citoyen, pour faire face aux défis climatiques. Résumé.
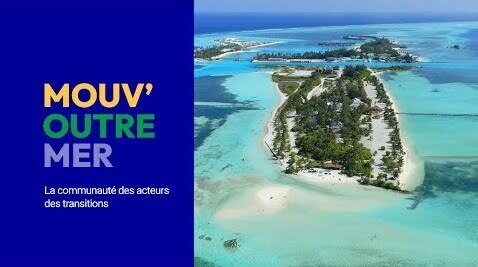
La science, pour qu’elle parle, doit être incarnée
Les chiffres ne suffisent plus à éveiller les consciences. Dans la lutte contre le dérèglement climatique, la science doit sortir d’une vision froide, non partisane et purement rationnelle, pour être vécue et incarnée. “On aime ce qui nous a émerveillés, et on protège ce que l’on aime”, disait Jacques-Yves Cousteau. Une maxime qui résonne avec force dans les Outre-mer, où la nature, l’océan et la biodiversité sont au cœur de l’identité des territoires.
C’est cette approche sensible que défend Matthieu Juncker à travers son projet A Contre Courant. Parti vivre 240 jours seul sur un atoll du Pacifique, il témoigne de la fragilité des écosystèmes ultramarins. “L’exploration sans le témoignage ne vaut pas le déplacement”, affirme-t-il. Pour lui, l’éveil des consciences passe aussi par l’émerveillement, les émotions et l’art — autant de leviers indispensables pour provoquer un vrai changement.
Les Outre-mer face aux dérèglements climatiques : double inégalité !
Grands oubliés des politiques climatiques nationales, les territoires ultramarins sont pourtant en première ligne face au dérèglement climatique. Tandis que la France hexagonale déploie des stratégies adaptées à un contexte continental, les îles ultramarines doivent composer avec des réalités bien plus aiguës : isolement, vulnérabilité accrue et spécificités locales encore trop peu étudiées.
En Martinique, Audrey Pastel, docteure en aménagement et adaptation au changement climatique, alerte sur cette inégalité. Elle souligne la faible capacité d’amortissement des îles face aux pressions environnementales, comparée aux régions continentales.
En effet, sur les atolls (îles des océans tropicaux et sommets de volcans immergés dont ¾ se situent dans le Pacifique et ¼ en Polynésie), autre front de la crise climatique, Matthieu Juncker a constaté l’ampleur des dégâts : près d’un tiers des colonies de coraux qu’il observait ont disparu en quelques semaines, victimes de canicules sous-marines. Ces îles volcaniques à fleur d’eau, parmi les plus vulnérables au monde avec les pôles, incarnent l’urgence d’une action ciblée.
Les populations de ces territoires ne sont pas responsables de cet effondrement écologique, mais elles en subissent déjà de plein fouet les conséquences.

La coopération, clé de l’adaptation
Face aux bouleversements climatiques, la protection des littoraux ne peut reposer sur une seule expertise. Audrey Pastel le rappelle dans ses travaux : la coopération interdisciplinaire et multi-acteurs est essentielle. Collectivités, scientifiques, artistes, citoyens, entreprises et associations doivent agir ensemble pour préserver les écosystèmes marins.
En Martinique, le projet 490littoral, une exposition itinérante mêlant art et sciences, illustre cette dynamique. En utilisant photographies, arts plastiques et digitaux, cette initiative sensibilise les populations à l’évolution du littoral et à la résilience des milieux naturels, tout en ré-enchantant et donnant un pouvoir d’action.
Remettre les sciences dans les mains de tous et toutes
Au-delà, il s’agit de replacer la science entre toutes les mains. En devenant accessible, participative et ancrée dans le quotidien, elle se transforme en outil d’action. François Tron et Matthieu Juncker militent pour cette approche, convaincus que l’implication des habitants, via des démarches de sciences participatives, crée un lien fort entre savoirs et territoire.
Mais cela suppose de repenser les formats, de vulgariser les données, et surtout, de créer des espaces d’échange où chacun peut comprendre, s’exprimer et agir. Car la transition écologique ne se fera pas sans les citoyens.

Quand on ne lutte pas pour alerter ou changer de système, on s’adapte
Si lutter contre les dérèglements climatiques est primordial, il faut en même temps anticiper et s’adapter. C’est cette approche que propose François, avec le projet régional Kiwa PEBACC+, en utilisant les solutions fondées sur la nature comme moyen, simple et peu coûteux, de renforcer la résilience des littoraux.
À Nouméa, l’entretien des chenaux dans les mangroves, la restauration de la végétation littorale et l'utilisation de cordons pierreux et de fascines de coco ont permis de stabiliser les sols et de restaurer la biodiversité, avec des résultats tangibles. Cette approche, ancrée dans les réalités locales et la connaissance de la nature, permet aux citoyens de s'approprier les solutions et de les adapter à leur propre environnement.
S’inspirer des pratiques traditionnelles marines de conservation de biodiversité
Les savoirs ancestraux ont souvent été négligés dans les stratégies modernes de conservation, ou pire, appropriés par des organismes et entreprises occidentales, sans aucun crédit. Pourtant, des pratiques comme le rāhui polynésien, qui consiste à interdire temporairement l’accès à un espace ou une ressource pour en favoriser la régénération, sont des exemples concrets de gestion durable des ressources naturelles.
En même temps, des initiatives comme celles prises par les Samoa, qui ont interdit la pêche dans une zone équivalente à celle du Vietnam, méritent d’être davantage valorisées, soutenues et entendues, en comparaison par exemple à la France Hexagonale qui protège réellement moins de 1% de ses eaux selon l’association Bloom.
Tamatoa Bambridge, directeur de recherche au CNRS qui s’intéresse aux savoirs traditionnels relatifs à la biodiversité marine, en témoigne : “80% des terres et des océans conservés aujourd’hui, c’est grâce à 4% de la population, tous des populations dites indigènes ou locales. Et c’est grâce à eux, en fait, qu’on a encore des environnements encore non perturbés.”
Pour une gestion vraiment durable de nos océans, considérons les pratiques et les solutions locales, riches de culture et de valeurs communes des populations ultramarines, comme “les gardiens innovants de notre biodiversité”, conclut Patrick Chamoiseau.

Mouv’outremer est une communauté d’acteurs et actices engagées dans les transitions écologiques et sociales dans les Outre-mer.
Plus d’informations sur le site web et sur la page Linkedin.