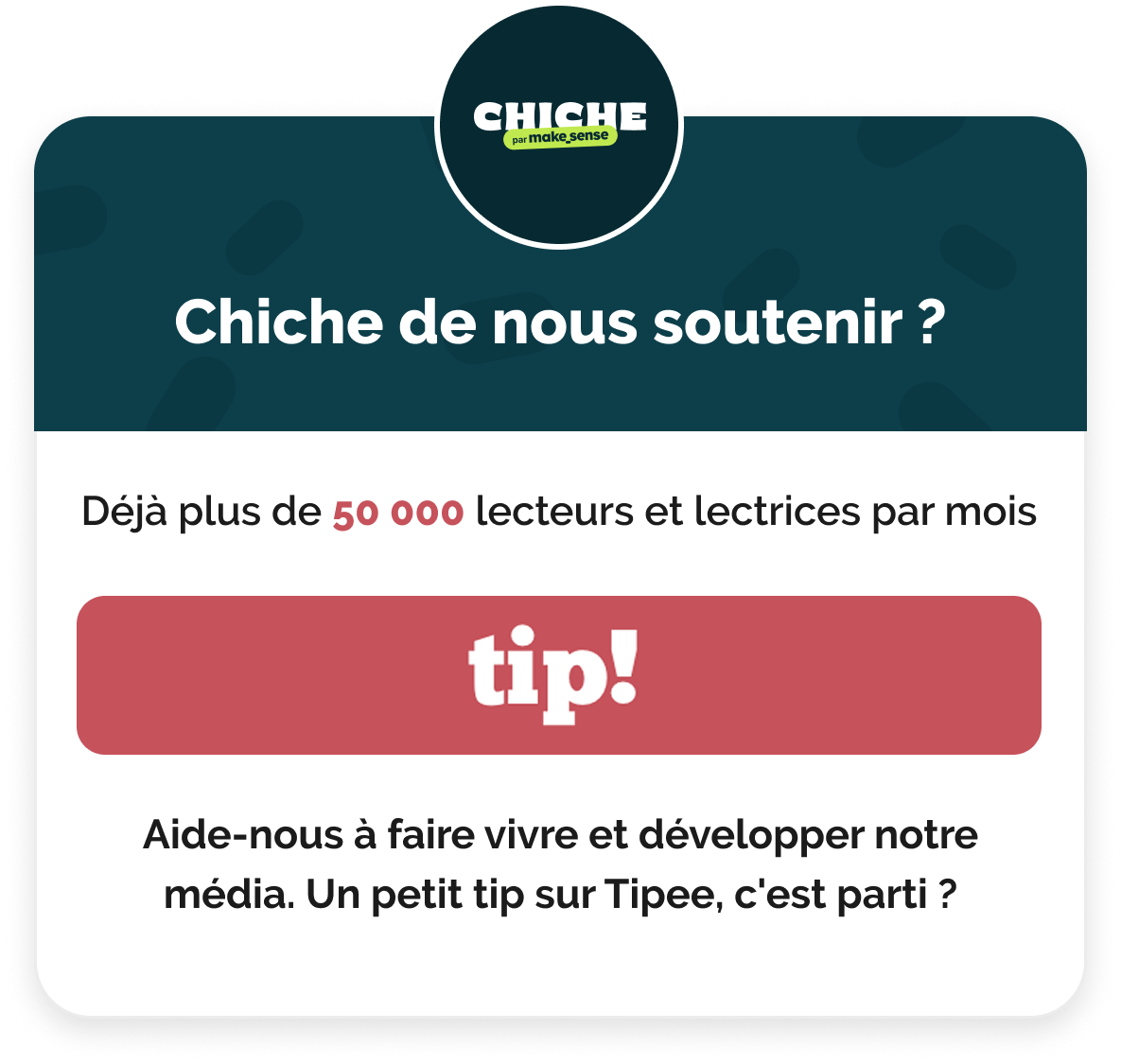Cet été, j’ai dit « oui » à l’amour de ma vie. Moi, la féministe engagée, qui écrit et défend les droits, la liberté et l’émancipation des femmes chaque jour. Pourtant, j’ai fait la totale : j’ai attendu qu’il fasse sa demande, je suis entrée au bras de mon père, et j’ai changé de nom de famille. Je sais, on a connu bien moins patriarcaux comme choix. Alors, est-ce que le 28 juin dernier, j’ai trahi mes convictions, aveuglée par l’amour ? Peut-on conjuguer rêve de petite fille élevée avec tous les codes genrés et patriarcaux, et engagement d’adulte ? Introspection en cours.
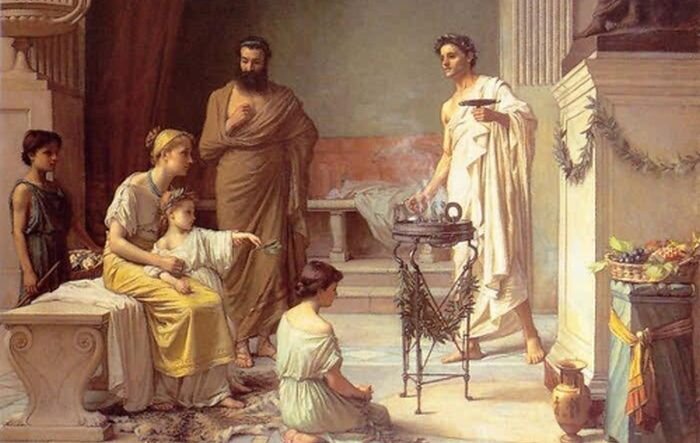
Il était une fois, un mariage leadé par le patriarcat
Bon, ok, si on fait un petit point sur l’histoire du mariage, autant vous dire que mes consœurs féministes ont tout ce qu’il faut pour me renier à tout jamais. Aussi loin que l’on puisse remonter, le mariage est une institution profondément patriarcale, puisqu’il tient la femme sous la tutelle d’un homme. Du père, au mari.
Pire, elle est pendant longtemps une forme de monnaie d’échange. Dès la Rome Antique, le pater familias donne - oui, comme un objet - sa fille pour forger des alliances - économiques ou politiques, pas les bagues - ou consolider son patrimoine.
Au Moyen-Âge, quand le mariage devient un sacrement religieux, les choses ne s’arrangent pas. Même si sur le papier, on passe théoriquement à un consentement mutuel, dans les faits, les pères gardent la main. On se met alors à prôner la procréation, on insiste sur la virginité de la fiancée, et hop, tour de magie : le mariage devient même un outil de contrôle de la sexualité des femmes. Pour couronner le tout, marié c’est marié, rompre c’est péché : le sacrement est imbrisable.
Au début du XIXe siècle, ce bon vieux Napolé(c)on n’arrange pas la sauce : le Code Napoléon instaure le statut de mineure de la femme mariée. En d’autres termes : il la place sous tutelle maritale, la privant de sa capacité juridique au même titre que les enfants. Cette tutelle ne sera levée qu’en... 1938. Moins de 90 ans en arrière. Top.
Après ce tour d’horizon historique du mariage, j’ai presque envie de me sacrifier moi-même sur l’autel de la trahison. Mais relativisons tout de même, aujourd’hui, le mariage, ce n’est quand même plus la même chose.
Traditions & féminisme : le mariage compliqué
Si vous demandez à n’importe qui de vous décrire une mariée, il parlera certainement d’une longue robe blanche, d’un voile, d’une bague de fiançailles puis d’une alliance, et de l’émotion de voir un père conduire son enfant dans l’allée. Toutes ces traditions qui nous font dire « waw » et pleurer le Jour J, alors qu’elles sont toutes plus patriarcales les unes que les autres dans leurs origines.
Mais voilà, perpétuer une tradition, parce qu’elle est ancrée dans notre vision profonde d’un événement aussi exceptionnel - au sens, où, on ne le vit pas tous les 4 matins -, est-ce vraiment en prôner l’origine ?
A titre personnel, je ne pense pas.
Ma robe était blanche, mais après 8 ans de vie commune avec mon mari, il était clair pour tout le monde qu’elle n’avait rien à voir avec ma sexualité. J’ai porté fièrement ma bague de fiançailles, non pas pour dire aux autres hommes que j’étais déjà promise, mais simplement par bonheur de m’engager et de voir mon mari s’engager à mes côtés.
Je porte son nom, mais pas parce qu’on m’y a obligé : parce que j’avais envie d’en changer, et que « Hazan Baudraz » ça sonne clairement comme un agent de police qui zozote. Flemme.
Mon père m’a amenée à l’autel, non pas pour me donner à mon mari, mais parce ce que c’était ma manière à moi de lui donner une place dans mon mariage.
Les traditions ont la peau dure, et s’en défaire demande du courage, de l’énergie, voire… de la logistique.
Certaines troquent la robe blanche contre des couleurs vives, rédigent leurs vœux avec leur partenaire, arrivent seules à la cérémonie, ou entrent au bras de leur mère. Certaines ont la force de personnalité de modifier les rituels, d’autres -comme moi-, décident de croire qu’il est possible de simplement les charger d’un autre sens sans pour autant trop en perturber l’apparence.

Le mariage, outil possible d’émancipation ?
Certains diront que je pousse peut-être le bouchon un peu loin ici, et pourtant... Quand on sort du schéma hétéronormé « classique » des couples trentenaires, le mariage peut être un levier de symboliques fortes. Que ce soit Le mariage pour tous, qui permet désormais à des couples non-hétéro de s’unir et d’accéder aux mêmes droits ; un couple de 70 ans, qui s’unit après s’être laissé une vie de pleine liberté ; ou encore, deux âmes-soeurs qui s’unissent contre l’avis de leurs religions ou familles,... Les exemples sont nombreux.
Et même, en restant dans le cadre du mariage hétérosexuel, on peut aussi parler d’émancipation. Aujourd’hui, dans un pays comme la France, on a la chance de pouvoir se marier uniquement par amour. Avoir le choix de se marier ou non, s’engager parce qu’on le veut au fond de soi et non pas parce que notre père le souhaite, c’est déjà, à mes yeux, et au regard de l’histoire, une forme de liberté gagnée.
Lire aussi → 9 livres féministes à lire toute l’année.
Oui, parce que n’oublions pas que la lecture de cet article ne peut se faire qu’en soulignant le caractère encore trop exceptionnel d'un consentement au mariage libre et éclairé. Partout dans le monde et dans tous les milieux sociaux, le mariage est encore imposé aux femmes et accompagné de violences sexistes et sexuelles.
Aux victimes de ces violences, nous adressons toute notre sororité.
Aujourd’hui, tranquillement assise devant mon ordinateur, j’ai le droit de parler de « contradiction féministe » à propos du mariage, quand certaines n’ont même pas le droit d’avoir cette contradiction-là.
C’est aussi à la lumière de ces réalités que je mesure le privilège que c’est, de pouvoir choisir mon mariage. Choisir qui j’aime, quand je veux m’unir à lui, et selon quelles modalités. Que j’ai le choix de perpétuer ou non les traditions. Ça n’en fait pas une liberté parfaite, mais c’est une liberté qui existe, et qui résulte du combat qu'ont mené nos mères pour que nos mariages soient le résultat de nos choix à nous, et à nous seules.
Alors finalement...
Si cet amour est libre, consenti, joyeux, construit sur l’égalité et le respect mutuel, alors il peut devenir un terrain d’expression féministe, et non de renoncement.
Il peut être l’endroit où l’on célèbre ce que l’on construit ensemble : un amour qui ne hiérarchise pas, un lien où l’on se choisit sans se posséder, où l’on s’engage sans s’effacer.
Nous, on a choisi de formaliser cette égalité là dans un contrat de mariage. Je t’aime, mais ce qui est à moi reste à moi, et ce qui est à toi reste à toi. Un contrat qui dit qu’on protège mutuellement ses droits, ses biens, sa liberté, au lieu de s’en remettre par défaut à un régime inégalitaire.
Certes, je n’ai pas choisi mon mariage pour assumer et prôner avec ferveur mes combats féministes. Pour autant, je n’ai pas le sentiment d’avoir trahi mes valeurs. Au contraire, être libre d’aimer qui l’on veut, libre de s’unir ou de ne pas le faire, libre de choisir comment, ce n’est pas contraire aux idées féministes. Dire « oui » aujourd’hui, c’est choisir avec conscience, loin des injonctions d’hier.
Marie Baudraz (eh oui, je vous l’ai dit, j’ai changé ! )