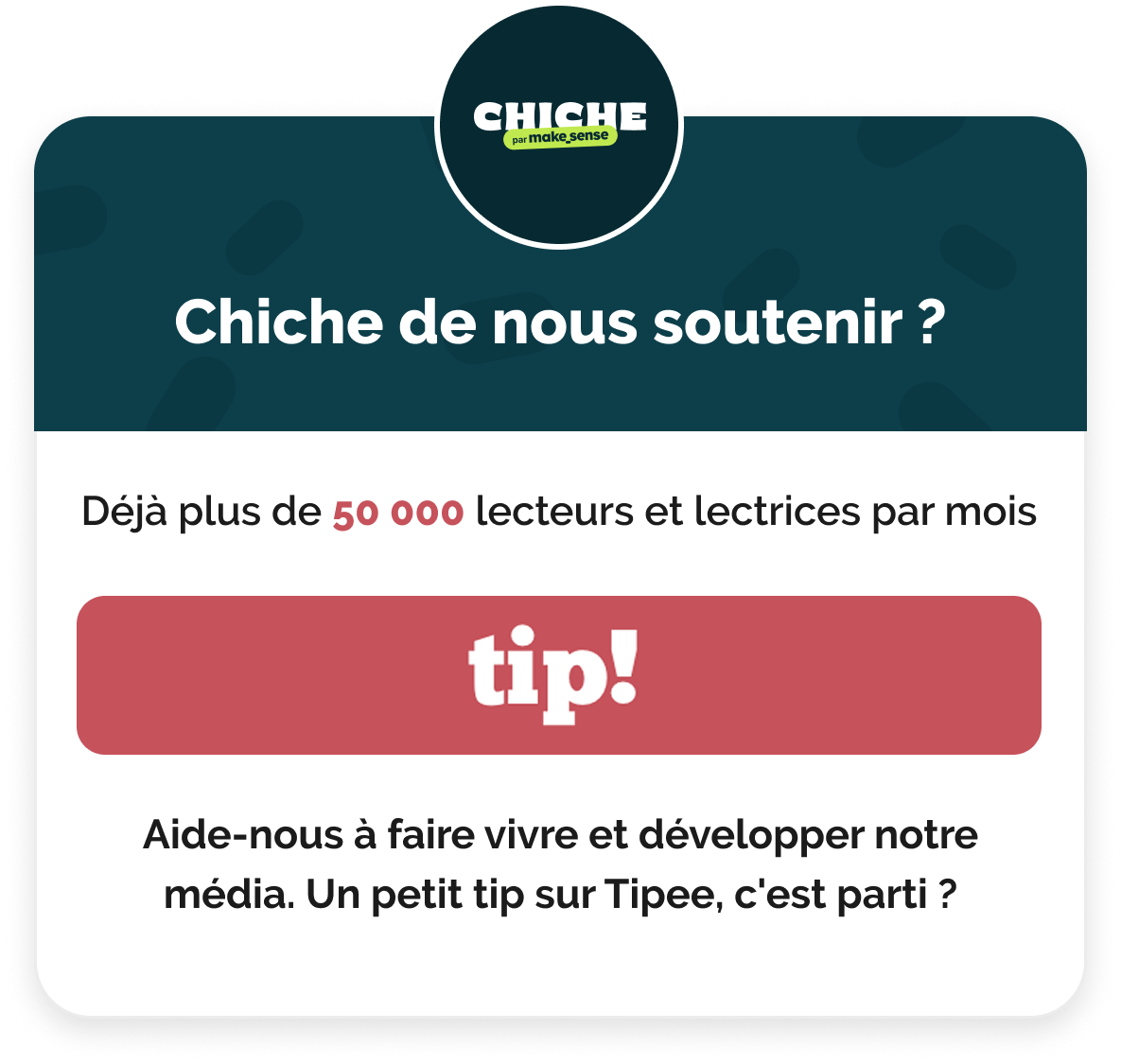L’été dernier, lorsque l’extrême droite est restée à la porte du pouvoir, beaucoup ont respiré et se sont dit : plus jamais ça. D’accord, mais il s’est passé quoi depuis et quelles sont les bonnes idées issues de la société civile pour que l’on évite ce scénario demain ? Florent Guignard fait le point.
7 juillet 2024, 20h et quelques minutes. Nous sommes au soir du second tour des élections législatives. Après une dissolution surprise et une campagne éclair de trois semaines, le Nouveau Front populaire (NFP) est arrivé en tête. Après avoir senti le souffle chaud de l’extrême-droite sur les portes du pouvoir, beaucoup sont rassurés. Sous l’objectif des caméras de télévision, des jeunes électrices se sautent dans les bras et s’étreignent. Ici, un jeune homme relâche la pression et fond en larmes de bonheur.
Le soulagement est à la mesure de la peur de voir le Rassemblement national (RN) au pouvoir en France, et également à l’aune de la mobilisation sans précédent qui vient d’avoir lieu.
Car c’est bien la société civile qui s’est mobilisée au lendemain des élections européennes. C’est bien cette société civile qui a fait pression sur les partis de gauche pour obtenir une union électorale, qui a ensuite passé des heures au téléphone pour convaincre individuellement les électeurs d’aller voter, qui a imaginé des visuels, des campagnes sur les réseaux sociaux, des chansons pour se mobiliser. Cette même société civile qui avait, avant ces élections, lutté contre la mal-inscription et contre l’abstention.
Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils ou elles s'engageaient politiquement, pour certains, c’était la première fois qu’ils et elles votaient. Pour celles et ceux qui ont quelques années de plus, ils s’étaient sans doute enthousiasmés pour la primaire populaire, et avant cela, à Ma Voix, à laprimaire.org, etc.

Et aujourd’hui ? Qu’est devenu cet espoir ? Cet engagement ?
Dès le lendemain de l’élection, les partis politiques ont entamé leurs négociations sur le nom d’une Première ministre, sur les priorités, les lignes rouges, la stratégie à adopter… et toutes celles et ceux qui s’étaient mobilisés ont été oubliés, dès le lendemain de l’élection. À peine quelques mercis avaient été prononcés que personne n’avait de place pour elles et eux, personne ne se souciait de leur avis, personne ne souhaitait abandonner une once de son pouvoir de décision… et les citoyennes et citoyens sont redevenus simples citoyens.
Demandez-leur, demandez-vous aujourd’hui ce que sont devenus l’espoir et l’engagement : souvent un souvenir joyeux depuis longtemps terni par l’amertume, une frustration, un sentiment glaçant d’attendre que l’histoire se répète, en pire, d’avoir grillé un joker pour simplement repousser une échéance qui semble devenir inéluctable.
Lire aussi → Front populaire 1936, raconte un peu
Mais alors pourquoi ? Pourquoi ce gâchis ? Pourquoi cette mobilisation sans lendemain, ces sentiments mitigés ?
Ces questions, j’ai eu la chance de pouvoir les explorer pendant un an. Retour en 2023. Je venais de déposer le bilan du Drenche, une entreprise de l’économie sociale et solidaire que j’avais dirigée pendant 7 ans. Le Drenche était un journal de débat, lancé en pleine vague des civic tech, ces entreprises persuadées qu’elles allaient sauver la démocratie avec les nouvelles technologies. Cet espoir ayant été douché il y a quelques années, le temps du bilan était venu. Et, cela tombait bien, c’était aussi le temps du bilan pour un petit groupe de la Primaire populaire.
Nous étions une dizaine d’activistes qui avions passé toute notre énergie ces dernières années à nous battre pour la démocratie, pour des grands combats sociétaux (l’écologie, le féminisme, la lutte contre les inégalités, etc.), mais nous avions tous et toutes un point commun : nous étions hors des partis politiques, et pourtant conscients qu’ils étaient un impératif pour nos combats.

Mais alors pourquoi ? Pourquoi les partis sont pour beaucoup d’entre nous un repoussoir ? Pourquoi n’arrivent-ils pas à donner une place à la société civile ? À nous ? À d’autres ? Aux minorités ?
Pour répondre à ces questions, nous avons créé une association (c’est moins cher qu’une psychothérapie) : le Labo des Partis. Nous avons mis sur pied un conseil scientifique composé de chercheuses et chercheurs qui étudiaient la question depuis plusieurs années, et nous avons cherché à répondre à cette unique obsession : Un parti politique pourrait-il fonctionner différemment et mieux ? “Différemment” voulant dire de manière plus démocratique, moins violente, plus inclusive. Et “mieux” voulait dire sans broyer les gens, sans repousser les bonnes volontés de la société civile, tout en étant capable de remporter des élections locales ou nationales.
Sans rentrer dans le détail, nous avons trouvé que oui (pour celles et ceux qui veulent entrer, dans le détail c’est par ici). Oui, un parti peut fonctionner de manière démocratique et gagner des élections. Oui, un parti peut inclure sans les maltraiter les femmes, les minorités visibles ou invisibles, et prendre en compte ces combats dans son programme. Oui, il peut constituer un espace d’engagement divers pour la société civile. Oui, et il y a même plusieurs modèles de gouvernance qui peuvent s’appliquer à un tel parti.
Deux questions nouvelles sont alors apparues. La première, et la plus naturelle, était sans doute : “mais alors, si c’est faisable, pourquoi c’est pas fait, bordel ?” (vous pouvez insérer le juron de votre choix, on n’est pas regardants). La question est légitime, mais ce n’est pas la plus intéressante. Une réponse un peu simplificatrice, mais globalement vraie, est qu’aucune des personnes qui compose les partis actuels, et à plus forte raison les personnes aux postes de pouvoir, n’a véritablement intérêt à mettre cela en place. Trop d’individus ont, dans l’opération, une place, un poste, un mandat, actuel ou espéré, à perdre.
La seconde question : du coup, comment est-ce qu’un tel parti peut se matérialiser ? C’est le second sujet sur lequel nous avons travaillé avec le Labo des partis. Et là, pas de réponse absolue : il y a un ensemble de conditions nécessaires, mais pas forcément suffisantes, pour qu’un tel parti émerge.
Les principales sont :
- d’avoir réfléchi en amont à des gouvernances de partis politiques (ça, c’est fait ! les résultats sont disponibles gratuitement ici : parce que si on n’y a pas réfléchi, c’est souvent une question qui passe à la trappe et pour lequel le fonctionnement impose une gouvernance de fait. En gros, il faut presque arriver avec des statuts tout faits.
- qu’à un moment, il y ait un espoir fort qui permette de mobiliser un grand nombre de citoyennes et citoyens (c’est ce qui s’est passé avec la Primaire populaire, ou plus récemment pendant les Législatives)
- que cet espoir ait un débouché concret, rassembleur, et immédiatement prêt.
Concrètement, c’est ce qui aurait pu se passer avant les Législatives, si le Nouveau front populaire avait été conçu comme un parti et non juste une alliance ; un parti démocratique, qui permette la double adhésion (au NFP et à un autre parti), qui rassemble toutes celles et ceux qui s’étaient mobilisés, plus quelques personnalités politiques diverses et emblématiques, et dont les élus auraient payé au moins une partie de leurs cotisations à ce nouveau parti. Mais ça ne s’est pas passé.
La bonne nouvelle, c’est que nous savons avec une quasi-certitude que le problème se reposera exactement sous les mêmes termes d’ici peu : alliance ou pas alliance, barrage ou pas barrage, avec qui, contre qui, jusqu'où, etc. Et ce jour-là, peut-être que l’occasion manquée la dernière fois pourra être saisie.
Peut-être.
Reste une question : la dernière.
Qu’est-ce qu’on attend ? Qu’est-ce qu’on attend pour préparer ce moment ?
Pour dire dès aujourd’hui : nous sommes les citoyennes et les citoyens qui veulent une société plus juste, plus inclusive, et plus respectueuse du vivant. Nous sommes nombreux. Nous sommes organisés. Nous sommes l’avenir. Voici nos règles du jeu, voici nos lignes rouges, voici ce que nous voulons pour la société. Que celles et ceux qui acceptent ces règles et se reconnaissent dans nos valeurs arborent nos couleurs et changent enfin cette société.
Qu’est-ce qu’on attend ?