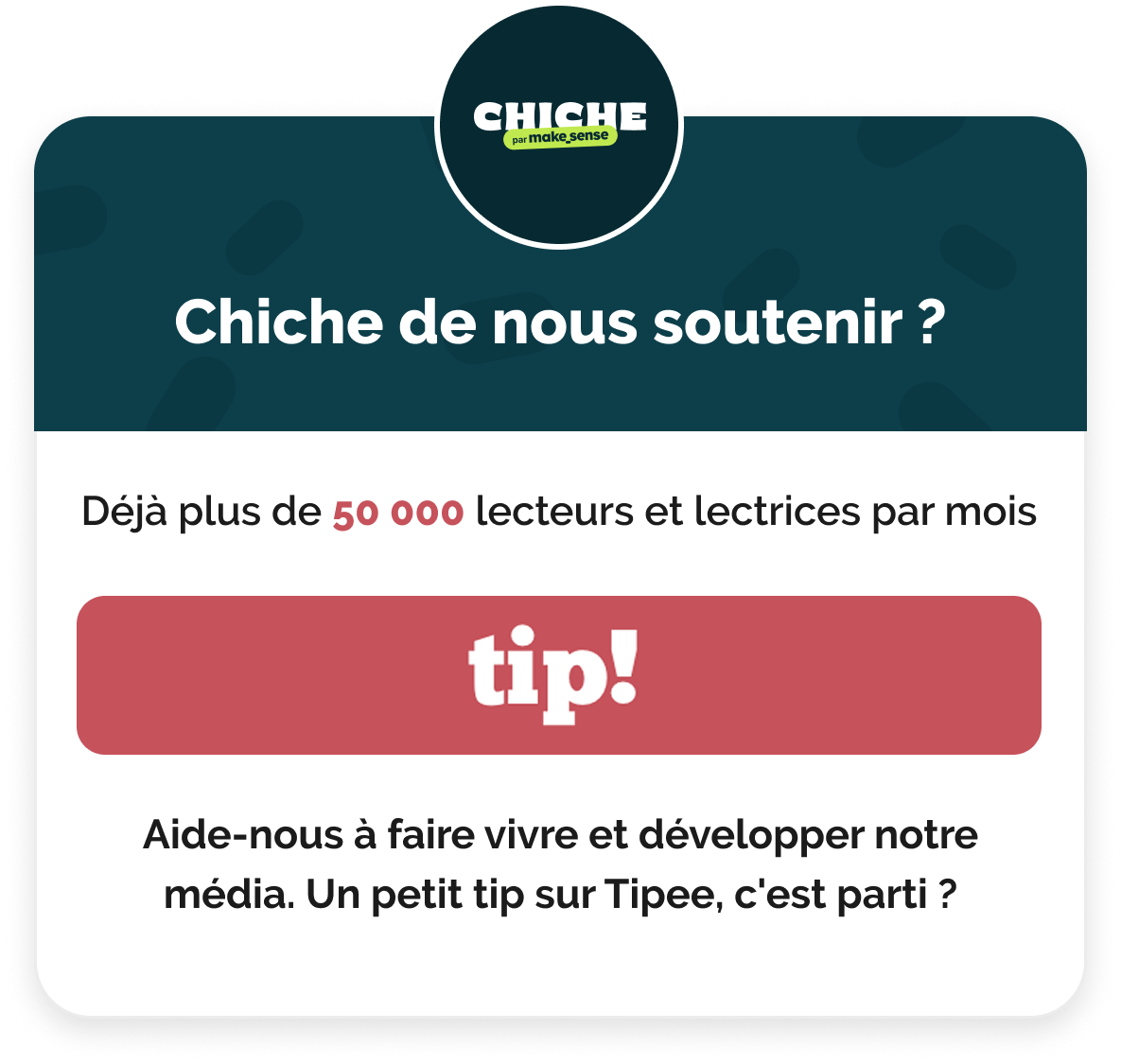On l’a reçu pour une soirée et on l’a élu le climatologue le plus doux du GIEC. Quand Christophe Cassou brise la glace climatique, c’est avec délicatesse, passion, lucidité et espoir. Extraits d’une discussion intime à +2°C.
Le climat et toi c’est une longue histoire qui commence par un ciel d’orage ?
Presque. Je viens des Landes, j'ai grandi dans un petit village au milieu des pins, à peu près à une quinzaine de kilomètres de Mont-de-Marsan. Lorsque j’étais enfant, je passais énormément de temps dans la nature, dans la forêt ou dans les vagues. J’allais mesurer la hauteur d’eau d’un petit ruisseau à 500 mètres de chez moi avec une échelle en bois que j'avais fabriquée. Je notais aussi la hauteur des vagues lorsque j’allais à l'océan avec mes parents. Je faisais des petits graphiques sur du papier millimétré.
À 8, 9 ans, je me souviens être ébloui et excité par les phénomènes atmosphériques. À cette époque-là, quand on est gamin, on ne sait pas ce que c'est que le climat. On vit simplement l'atmosphère ; on perçoit uniquement le temps qu’il fait, c'est-à-dire la météo. J'étais fasciné par les orages, par les tempêtes, par tous les éléments. Dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire mes premières mesures météo avec une station en bois que mon grand-père m'avait construite. J'étais super exigeant comme gamin, parce qu'il fallait que les dimensions et toutes les caractéristiques techniques de la station météo, l’isolation, la distance à un obstacle, etc., soient exactement celles qui étaient préconisées par l'Organisation Mondiale de la Météo pour que ce soit une “vraie station”. J'étais le gamin le plus heureux du monde avec mes instruments et mes drapeaux qui me servaient de girouette et mon grand-père n’était pas peu fier.
Le gène du climat t’a-t-il été transmis par tes parents ?
Pas du tout, mes parents étaient tous les deux fonctionnaires à la Sécurité sociale. Lorsque j’étais enfant, mon père m’avait inscrit dans le club de foot du village, dont il était le trésorier. J’y allais plutôt par devoir moral car franchement, ça ne m’intéressait pas. Un jour, alors que mon équipe était arrivée en demi-finale du championnat des Landes, catégorie “poussin”, pendant le match, je me souviens qu’il y avait des nuages incroyablement beaux dans le ciel. Moi je n'avais strictement rien à faire de ce potentiel accès à la finale, j'étais juste fasciné par les développements orageux, les éclairs et le tonnerre au loin… Je me suis arrêté de jouer, je me suis planté devant mon père et lui ai dit que le foot ne m’intéressait pas et que la seule chose que voulais, c’était tout simplement regarder les gros cumulonimbus en formation. Ce soir-là, il a compris. Par la suite, avec ma mère, il m’a toujours soutenu et encouragé dans ma passion. La preuve, tous les deux ont toujours pris le relais de mes mesures météo quand je m’absentais pendant les vacances parce que je ne voulais absolument pas de rupture dans ma série d'observations. J’avais lu dans un bouquin qu’il n’en fallait pas. Mes parents s’investissaient parce qu’ils avaient pris conscience que ça me faisait plaisir et que c'était important pour moi.

Tout cela t’a bien réussi. Aujourd’hui, tu travailles en tant que climatologue directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), tu es l’un des auteurs principaux du sixième rapport du GIEC. Pourtant tu restes particulièrement proche du public avec tes publications, tes prises de parole, ton parrainage du nouveau Journal de la Météo et du Climat sur France Télévision, ton train du climat…
Ah, le train du climat, c’était un projet complètement fou qui date maintenant de 10 ans. On l’a imaginé à quatre, Serge Planton, un climatologue de Météo France, Catherine Jandel, une océanographe du CNRS, et moi-même, pour la partie scientifique du projet et puis, une personne assez extraordinaire, Béatrice Kork, qui était alors directrice de la culture scientifique et technique à Toulouse. En 2014, on s'est réunis autour d'une pizza, tous les quatre frustrés parce qu'en amont de la COP21, tout se passait à Paris. Il y avait une vraie invisibilité de toutes les initiatives et projets qui se faisaient en province en matière de communication et de médiation sur les enjeux climatiques. On a donc pensé à une exposition dans un train qui sillonne la France, pour rendre visible la recherche publique sur les sciences du climat dans tous les territoires. Pour cela, on a créé un collectif de chercheurs et chercheuses, qui s'appelait les Messagers du climat.
Notre idée était d’embarquer les Messagers dans un train aménagé en exposition itinérante pour aller à la rencontre du grand public dans les gares, des lieux inhabituels pour les sciences et ce, partout en France, en particulier dans les villes de moyenne et petite taille. Au final, dans 19 villes-étapes nous avons partagé avec le public les mécanismes physiques du climat, les risques climatiques dans un climat réchauffé par les activités humaines mais aussi les solutions à mettre en œuvre en matière de décarbonation et d’adaptation à un climat qui change vite. Lors de chaque étape, les Messagers du Climat animaient des ateliers, conférences ou rencontres pour favoriser le dialogue science-société. Au final, on était 45 chercheurs et chercheuses impliqués ; on voyageait de nuit dans le train, on ouvrait l’expo dans la journée et au total, on a accueilli plus de 25 000 visiteurs, dont 5000 scolaires et environ 1500 élus, le tour sur 3 semaines juste avant la COP de Paris.
Depuis, 10 ans ont passé et en juin dernier, on a appris de tes consœurs et notamment de Valérie Masson Delmotte (en tête aussi de notre classement des climatologues préférés) que l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, fixé lors de l’accord de Paris sur le climat il y a dix ans, « n’était désormais plus atteignable ». C’est quoi le moral des chercheurs et chercheuses dans ce contexte ?
Le mot qui me vient à l'esprit, c'est la détermination. Même si les vents sont contraires et forts, et avec des rafales aujourd’hui plus violentes , il faut s'agripper pour pouvoir résister. On est dans une phase de résistance face à la désinformation, face à une véritable entreprise de destruction de la fabrique des sciences. Pas toutes : celles qui dérangent, celles de la durabilité incluant le climat, la santé, la gestion durable des écosystèmes, la justice environnementale, etc. Les enjeux environnementaux sont instrumentalisés pour devenir des objets de clivage, des objets d’affrontements, d'oppositions stériles, de division entre communautés/catégories sociales. Tout est bon : la désinformation, la manipulation et déformation des faits, le discrédit des porteurs de faits scientifiques que nous sommes, les tentatives de distraction, la démagogie et le populisme pour éviter de parler du fond. Et bien sûr l'intimidation pour faire taire. Ces stratégies d’obstruction sont violentes et on se doit d'être vraiment déterminés, ancrés sur nos appuis pour continuer à porter les enjeux avec l'espoir de peser par les faits scientifiques objectifs et rationels, sur cette transformation sociétale que l'on va être obligés de faire. Autant la choisir vers plus de bien-être plutôt que de la subir avec beaucoup de casse.

Et toi comment ça va niveau éco-anxiété ?
Je résiste mais j’avoue avoir été très affecté cet été. J’étais en vacances dans les Pyrénées au moment des incendies en Espagne. Là où le paysage est normalement bien vert et humide, le ciel était rouge dû aux fumées, la montagne poussiéreuse et les petites sources d’eau que je connaissais par cœur depuis mon enfance, étaient à sec. J'ai senti une très forte angoisse parce que tous mes réflexes liés à cet environnement familier étaient chamboulés par le changement climatique. C’est la première fois que je suis rentré triste d’un bivouac alors que la montagne avait toujours été ressourçante et régénérative pour moi.
Cette angoisse a-t-elle décuplé ton désir d’agir (déjà bien haut) ?
En rentrant, je me suis dit qu’il fallait ne rien lâcher et que je pouvais peut-être jouer un rôle pour interpeller les politiques sur les questions de sécheresse et chaleurs extrêmes dans le cadre des élections municipales. Comment ? En me basant sur des chiffres qui évaluent les risques puisque c’est ma spécialité. Je veux leur rappeler qu’en quatre mandatures municipales, entre 2014 et 2032 la probabilité de vivre la canicule de 2003 (soit 15 000 morts en France, 70 000 morts en Europe et des conséquences sur la biodiversité encore visibles aujourd'hui), aura été multipliée par 10. Il est essentiel aujourd’hui pour les maires de prendre les mesures d’adaptation qui doivent protéger les personnes et les biens - la première mission de la puissance publique, - tout en décarbonant.
À ce propos, quels sont les liens entre le monde de la recherche et les politiques ?
Aujourd’hui, on essaye d'avoir des relations un peu plus fréquentes, un peu plus constructives et dans l'écoute respective. On vit un moment intéressant où des dynamiques de dialogue entre science et société émergent. Mais chacun son rôle ! Le scientifique informe et le politique décide. Je le répète souvent parce que les politiques nous demandent parfois ce qu'il faudrait faire. Ils nous font alors porter la charge de l’action ou la responsabilité des choix, alors qu’on n'a aucune légitimité en tant que scientifique de dicter les décisions qu'il faut prendre. Il faut les prendre de manière démocratique ! Notre rôle en tant que scientifique est d’apporter le socle des connaissances de manière factuelle, objective, impartiale, et transparente comme aide à la décision.
Au quotidien, les élus nationaux peuvent nous solliciter pour des expertises au Sénat et à l'Assemblée nationale, ou alors pour des enquêtes parlementaires, par exemple sur l’autoroute A69. Pour ces enquêtes, on est vraiment comme dans un tribunal, on jure de dire la vérité, toute la vérité. Les élus aussi d’ailleurs. Je crois que je serai toujours habité par l’image du petit provincial qui arrive à Paris et qui reste très impressionné par l'Assemblée nationale, avec ce sentiment de ne pas “être à sa place” et de ne pas se sentir légitime dans mon statut lors de ces échanges avec les parlementaires. Les biais d’imposture sociale sont coriaces et je dois les affronter souvent! Je suis stressé et j'ai très très peur, du coup, de ne pas être assez précis, juste… J’essaye d’apprivoiser tout ça. Ce qui dégoûte un peu quand même, c’est que certains parlementaires n’ont pas visiblement la même conception de la vérité et mentent sous serment. Mais moi, je peux me regarder dans une glace.
On en est à la 30e COP, Trump prend des décisions insensées pour le climat … question à 3000 euros, est-ce que tu as encore de l’espoir ?
Je ne sais pas si la question de l’espoir est bien posée ; en tout cas ce n’est pas l’espoir qui me fait m’engager dans l’espace public. C’est plutôt un devoir, un devoir moral, humaniste, éthique. Nous vivons déjà les effets du changement climatique et ce n’est que le début. J'espère que l’on pourra compter sur la solidarité, une valeur que je porte lors de mes interventions. Cette solidarité doit être dans les politiques d'adaptation au changement climatique, et doit initier la modification en profondeur de nos comportements face aux risques et surtout aux inégalités face aux risques. Sans solidarité, on n'y arrivera pas. Mais, globalement, on n’est pas mauvais pour s’entraider dans des moments d’adversité. Alors oui, il faut encore y croire.