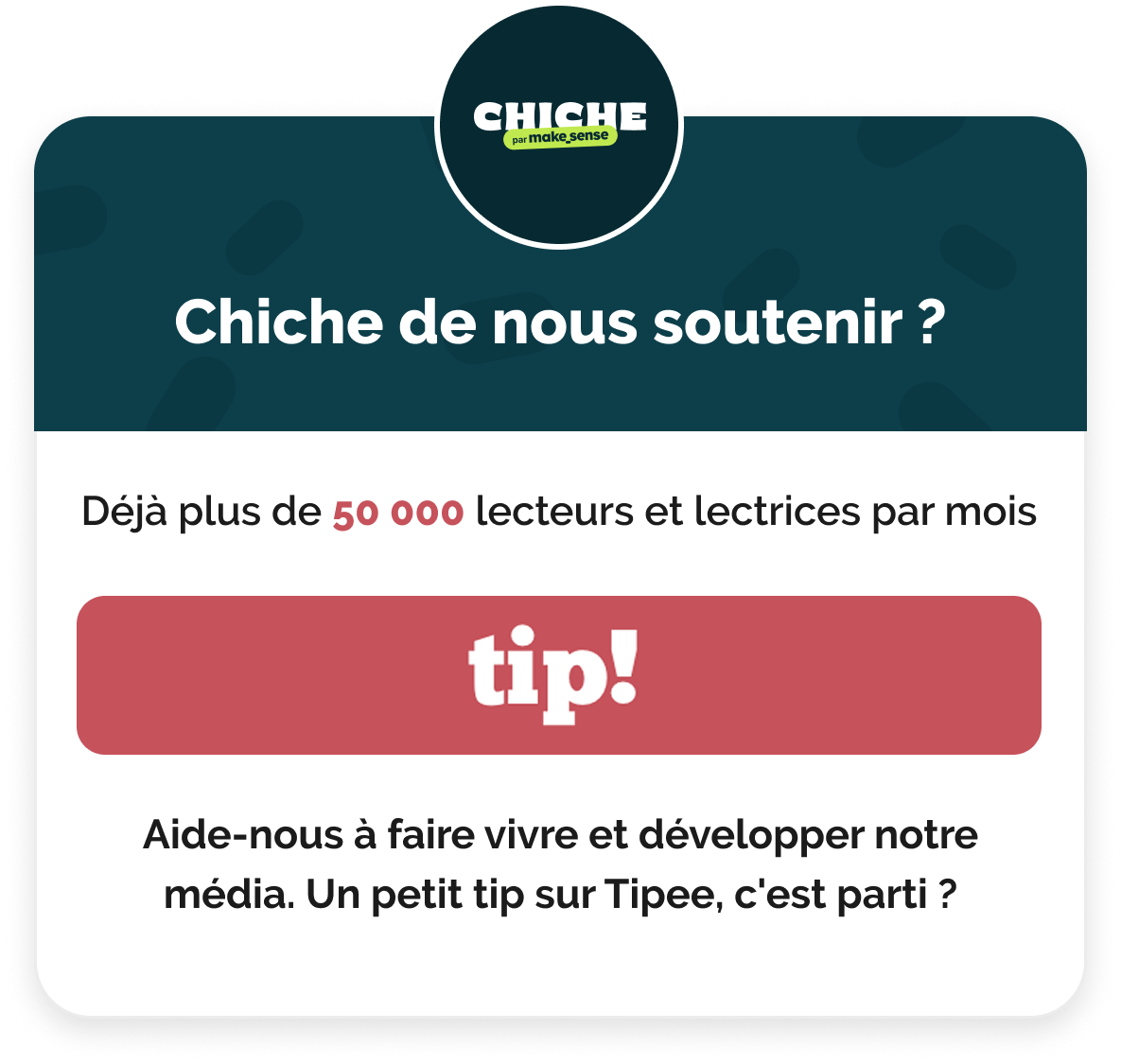On veut tous et toutes vivre vieux, mais surtout pas comme les vieux. Bienvenue dans l’ère de l’âgisme : celle où la vieillesse fait peur, où les rides font fuir, et où l’on finit par discriminer la personne qu’on deviendra demain.
Il parait que c’est dans les plus vieux pots que l’on fait les meilleures confitures. Pourtant, quand on parle de vieillesse, les cœurs s'affolent, et l’on se retrouve rapidement sous une pluie de crème anti-âge. Dans notre société obsédée par la jeunesse, la vieillesse fait peur. Les rides deviennent des signes de faiblesse, les cheveux blancs, des vecteurs d’exclusion. Mesdames et Messieurs, nous vous présentons le pire des compagnons de route pour nos aînés : l'âgisme. Laissez-nous vous expliquer ce qui se cache derrière ce terme, celui qui en plus de vous mettre un pied dans la tombe, vous fait évoluer dans un monde qui croit que vous y êtes déjà.

L'âgisme, Kézako ?
Comme beaucoup d’autres mots finissant par « isme », « l’âgisme » n’a rien de sympathique.
Ce terme, inventé par le gérontologue américain Robert Butler en 1969, dénonce une discrimination fondée sur l’âge. Plus on est vieux, plus on subit : ce sont principalement les séniors qui en sont victimes.
Tout commence par les relations humaines. Penser qu’une personne âgée est forcément dépassée ou fragile, la juger immédiatement vulnérable, prendre une décision à sa place, ou même faire preuve d’une compassion excessive uniquement motivée par le nombre d’années qu’elle semble cumuler : c’est de l'âgisme. Même si ces actions ne sont pas forcément volontaires ou mal intentionnées, elles participent à marginaliser le troisième âge. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties… ni vers la perte d’autonomie !
Mais ce n’est pas tout. Les discriminations liées à l’âge vont au-delà des rapports entre individus. L’âgisme est aussi imprégné dans notre société, davantage pensée pour les jeunes.
Dans les services publics et privés, on fait face à un accroissement de technologies non inclusives, ou à des politiques qui ne prennent que partiellement (voire pas) en considération les besoins de nos aînées.
Lire aussi → Ces vieux et ces vieilles qui nous inspirent
Dans le domaine de la santé, les plus âgés sont parfois considérés comme “non prioritaires”.
Dans le monde du travail, l’âge est un obstacle à l’embauche et à la formation. Dans les médias, les discours politiques, les campagnes publicitaires… les personnes âgées sont aussi sous-représentées, quand elles ne sont pas carrément invisibilisées. Spoiler Alert : les personnes âgées peuvent aussi faire de la pub pour autre chose que des crèmes anti-rides ou des prévoyances décès.
Selon l’OMS, c’est dès l’âge de 4 ans que les enfants intègrent les stéréotypes liés à l’âge.
Alors, qui sont les âgistes ?
Eh bien… Un peu tout le monde, en fait. Nous avons tous grandi dans une société qui a tendance à mettre tous les anciens dans un même panier, panier supposément rempli de couches, de dentiers, de déambulateur et d’appareils auditifs.
Mal juger les vieux, ça commence jeune ! Selon l’OMS, c’est dès l’âge de 4 ans que les enfants intègrent les stéréotypes liés à l’âge. Alors qu’on ne sait pas encore colorier sans dépasser, on adapte déjà nos comportements envers les personnes en fonction de leur nombre de printemps.
C’est aussi pour ça que l'âgisme passe incognito : on a tellement intégré l’idée selon laquelle la vieillesse induit le déclin, qu’on a aussi intégré et normalisé tout un tas de stéréotypes liés. À nous tous et toutes qui disons, souvent sans mauvaise pensée, des phrases comme “Il est encore en forme pour son âge !”, “Faire ça, à son âge, c’est courageux”, “C’est plus de leur âge”,... Nous entretenons la discrimination.

En avançant dans la vie avec ces pensées, on se retrouve parfois à s’auto-discriminer. C’est le cas de nombre de personnes âgées qui considèrent qu’elles ne sont plus capables, qu’elles ne sont plus utiles ou qu’elles n'intéressent personnes, à cause de leur âge. On appelle ça de l’auto-agisme.
Quelles sont les conséquences ?
L’âgisme tue. Oui, c’est trash, mais c’est vrai. Selon l’OMS, les personnes victimes d’âgisme voient leur espérance de vie réduite de 7,5 ans en moyenne. L'âgisme isole, crée des solitudes, des sentiments de dépendance envers l’entourage, et une exclusion sociale. L’isolement social est considéré comme un facteur à risque dans le domaine de la santé. Il est souvent associé à la dépression et à des troubles cognitifs.
Le 30 septembre 2025, Petits Frères des Pauvres tirait la sonnette d’alarme : cet isolement extrême de nos aînés explose. Aujourd’hui, en France, 750 000 personnes âgées sont en situation de “mort sociale”. Avec le vieillissement de la population, et si rien ne change, ce chiffre pourrait atteindre le million d’ici à 2030. Mettre les plus âgés au placard, c’est aussi éroder la solidarité entre les générations, se priver de savoirs et d’expériences passées.
Face à ces réalités, lutter contre l’âgisme devient une évidence. Certes, pour modifier des comportements aussi ancrés dans les habitudes de notre société, il faudra du temps. Mais chacun à son échelle, on peut déjà commencer à entamer la marche, en apprenant à changer notre regard sur les anciens qui nous entourent.
Si rien ne change et que l’on finit tous et toutes par vieillir (parce que SPOILER, oui, c’est la suite logique de la vie), alors l’âgisme devient aussi la seule discrimination dont on finira tous victimes. La seule chose qui doit mal vieillir, finalement, c’est elle.